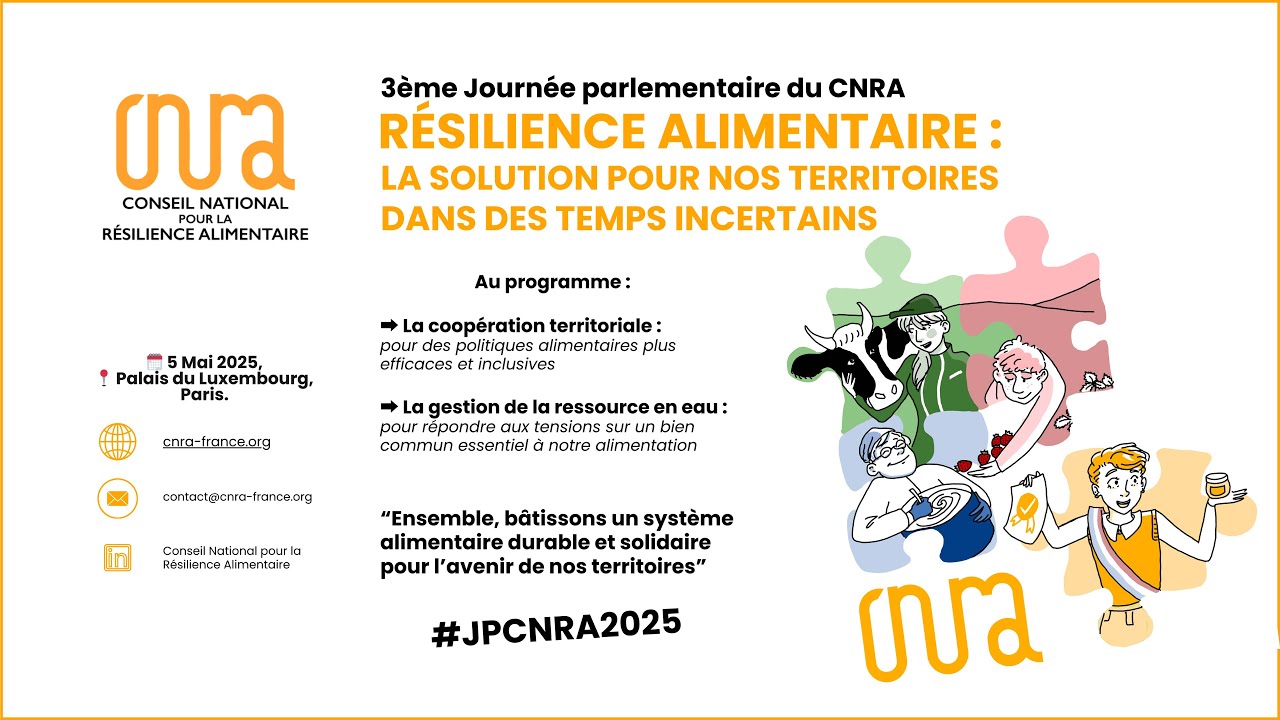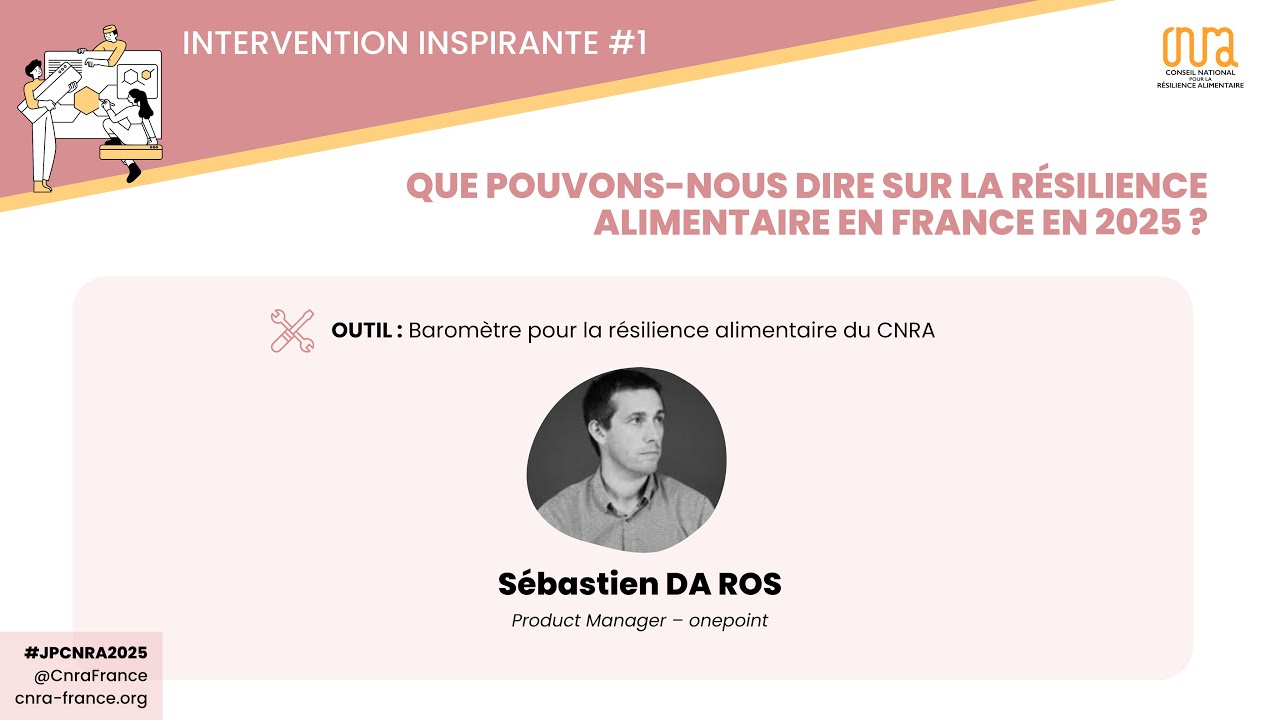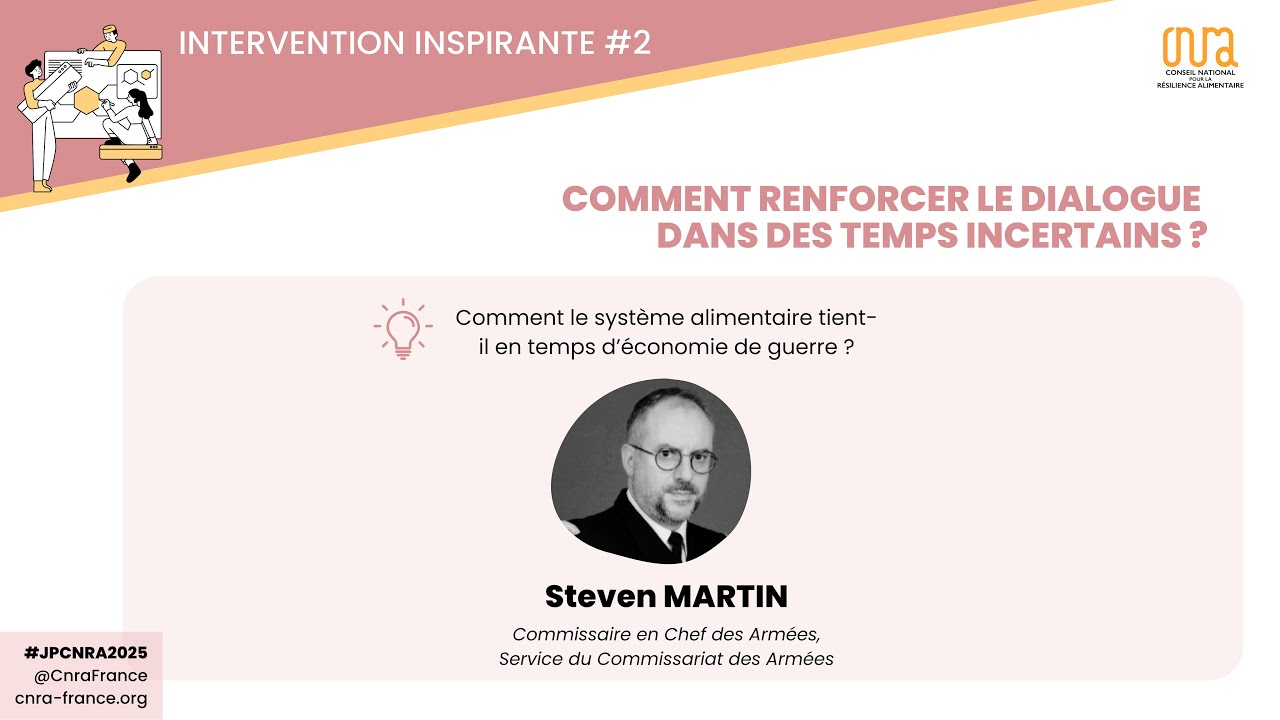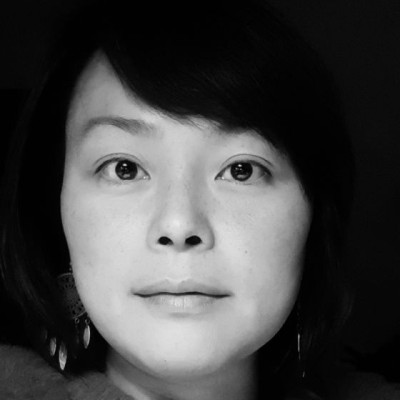3ème Journée parlementaire du CNRA
Edition 2025
La 3ème Journée Parlementaire de la résilience Alimentaire le 5 mai 2025
Fort de son succès grandissant, le CNRA a accueilli la 3ème journée parlementaire pour la résilience alimentaire, au sénat le 5 mai 2025. Ce rendez-vous désormais incontournable illustre la volonté de faire de cette thématique une priorité nationale, jusqu’à ce que la résilience alimentaire devienne une réalité concrète dans nos territoires.
Depuis ses débuts, le CNRA s’est donné pour mission d’accélérer le passage à l’échelle des solutions qui répondent aux défis de la résilience alimentaire. En rassemblant un écosystème d’acteurs varié — pouvoirs publics, entreprises, startups, associations et institutions —, il œuvre à bâtir des passerelles pour transformer les idées en actions durables et impactantes.
Lors des précédentes éditions, la résilience alimentaire a été abordée sous un prisme à la fois pragmatique et inspirant :
- URGENTE, car le temps des constats est révolu : l’action ne peut plus attendre.
- MESURABLE, car tout progrès se nourrit d’indicateurs fiables et concrets.
- POSSIBLE, car les solutions existent, elles ont été identifiées, éprouvées et méritent d’être amplifiées.
- DÉSIRABLE, car la résilience alimentaire, loin d’être un concept austère, doit devenir un objectif accessible et engageant, à bâtir pas à pas, au quotidien.
Avec cette 3ème édition, le CNRA renouvelle son engagement et invite les acteurs de tous horizons à conjuguer leurs forces pour faire émerger des territoires plus solidaires, plus durables et résolument tournés vers l’avenir. Le 5 mai 2025, cette journée parlementaire a été une nouvelle étape dans la construction collective d’une ambition commune : bâtir un modèle de résilience alimentaire à la hauteur des enjeux de notre époque.
Revivez la 1ème journée parlementaire
Programme
9h00– 9h30 – Accueil café
9h30 – 10h00 – Introduction
- Mot de bienvenue de Gérard Larcher, Président du Sénat
- Propos introductifs de Annie Genevard, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
- Accueil par Bernard Ader, Président et Hermine Chombart de Lauwe, Déléguée générale du CNRA
10h – 10h15 – Intervention inspirante #1 : « Que pouvons-nous dire sur la résilience alimentaire en France en 2025 ? »
Dans un contexte de crises multiples qui affectent l’ensemble des secteurs, quel regard porter sur la démarche de résilience alimentaire ? Quel est l’état des lieux national de la résilience alimentaire ? Quelles sont les solutions proposées par le CNRA pour accélérer et faciliter l’engagement des acteurs territoriaux ?
- Yuna Chiffoleau, INRAE – Etat des lieux des enjeux de résilience alimentaire en France
- Sébastien Da Ros, Onepoint – Baromètre de résilience alimentaire du CNRA
10h15 – 11h15 – Table Ronde #1 – « Comment renforcer la coopération territoriale à tous les niveaux pour une transition ambitieuse et partagée ? »
La crise démocratique actuelle interroge notre capacité collective à bâtir des solutions viables à partir de la diversité des réalités territoriales. Tous les niveaux de décision sont concernés – du local à l’international – et toutes les parties prenantes doivent pouvoir contribuer. L’un des défis structurants des prochaines décennies : faire émerger un dialogue constructif et efficace entre tous les niveaux.
- Linda Reboux, Banque des territoires – Financement de la transition : levier de dialogue territorial efficace ?
- Isabelle Dubois, Communauté de communes de la Dombes – Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), vecteurs d’une coopération inter-territoriale ?
- Olivier Feno-Feydel, Vivalya – Les acteurs économiques : moteurs de l’action collective ?
- Réaction des parlementaires
11h15 – 11h30 – Intervention inspirante #2 : « Comment le système alimentaire tient-il en temps d’économie de guerre ? »
- Steven Martin, Commissariat des Armées – Quelles nécessaires adaptations ? Les activité agricoles et alimentaires sont-elles des armes géopolitiques dans un contexte d’économie de guerre ? Quel rôle des armées pour des systèmes alimentaires plus résilients ?
- Sandrine Espeillac, AFNOR – Passer collectivement à l’action – Guide AFNOR et Formation Résilience alimentaire Comprendre et agir pour son territoire du CNRA
11h30 – 12h45 – Table Ronde #2 : « La ressource en eau comme base de la transition écologique de notre système alimentaire ? »
Alors que la loi d’orientation agricole, la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique et la remise en cause de certaines agences publiques mobilisent le débat, cette table ronde explore une piste concrète : considérer la résilience alimentaire comme une voie crédible pour engager la transition écologique. Un zoom particulier est proposé sur les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau.
- Somhack Limphakdy, Enseignante-chercheuse en philosophie du droit – L’eau : un bien commun ou une simple ressource ?
- Aude Witten, Agence de l’eau Adour-Garonne – Doit-on se préparer à une guerre de l’eau ?
- Marie Kieffer, ABEA Coopérative – Quels leviers pour optimiser la consommation d’eau dans les processus industriels ?
- Réaction des parlementaires
12h45 – 13h00 – Intervention inspirante #3 : « Quelles leçons tirer de ces échanges pour la résilience alimentaire de nos villes ? »
- Lionel Pancrazio, auteur et chercheur en stratégies durables pour la ville
13h – 14h30 Cocktail – Networking : Venez échanger avec les intervenants
Synthèse
Ouverture institutionnelle : poser les bases d’une réflexion collective
Bernard Ader : distinguer résilience et souveraineté alimentaire
Le président du CNRA a ouvert cette journée en rappelant l’essence de l’association : « une association faite de cœur, de tripes et de bonne humeur », loin des « mots creux » et « mots calibrés ».
Bernard Ader a établi une distinction fondamentale qui a irrigué toute la journée entre résilience et souveraineté alimentaire. La résilience porte selon lui une notion de temps long, d’analyse, de compréhension et de vision holistique, tandis que la souveraineté adopte une approche plus court-termiste, parfois simpliste dans son approche « un problème, une solution ». Cette vision holistique constitue le cœur de l’approche du CNRA, qui entend diplômer ses membres « plus intelligents » en les amenant à apprendre de l’expérience des autres.
Dans un contexte géopolitique tendu, Bernard Ader a également alerté sur les risques de « trumpisation du monde » et de détricotage des avancées environnementales, positionnant le Sénat comme « dernier bastion de raison et de sagesse » face à un monde qui semble avoir perdu la raison.
Le CNRA : un acteur de mise en réseau et d’outillage
Hermine Chombart de Lauwe a présenté les fondements du CNRA, association d’intérêt général de quatre ans d’existence structurée autour de deux piliers indissociables. La transversalité des enjeux alimentaires traverse les politiques écologiques, sociales, économiques et sanitaires, nécessitant une représentation de l’entièreté de l’écosystème alimentaire dans chaque action. La territorialité des solutions ancre les transformations au plus près des besoins et des ressources locales, le CNRA étant convaincu que la résilience alimentaire devient concrète et opérationnelle par les acteurs de terrain.
Cette philosophie se traduit par une organisation en quatre collèges représentant producteurs, entreprises, associations et acteurs publics, tous nécessaires à toute discussion sur la résilience alimentaire.
L’action du CNRA s’articule autour de trois axes complémentaires :
- relier les acteurs en servant de hub de rencontres,
- influencer en apportant à la fois une vision haute qui connecte et réconcilie les injonctions multiples et en étant à l’écoute des signaux faibles
- outiller en fournissant des moyens concrets de passer à l’action sur les territoires.
Un contexte politique favorable mais des défis persistants
Représentant Gérard Larcher, président du Sénat, le sénateur Yves Bleunven a rappelé l’ancrage rural du Sénat, où trois quarts des sénateurs sont issus de territoires ruraux, créant une sensibilité particulière aux enjeux agricoles et alimentaires. Cette proximité se traduit par une priorité accordée à l’agriculture dans l’ordre du jour du premier trimestre 2025, avec l’adoption de quatre textes spécifiques. La reconnaissance de la souveraineté alimentaire comme intérêt national majeur depuis début 2025 marque une évolution significative des politiques publiques.
Cependant, les paradoxes demeurent criants. Yves Bleunven a souligné qu’un poulet sur deux consommés en France est désormais importé, alors que la France exporte 80 % de ses déjections
animales. Cette situation illustre un passage douloureux du statut de premier exportateur mondial de volaille dans les années 80 à une dépendance croissante. Le sénateur a même confié préférer parler de « Conseil national de la résistance alimentaire », témoignant de trente ans d’accompagnement contraint de la décroissance de la production française
La ministre Annie Genevard, dans son message vidéo, a réaffirmé que la souveraineté alimentaire et la souveraineté militaire relèvent du même niveau d’importance stratégique. Elle a rappelé les outils existants, notamment les Projets Alimentaires Territoriaux qui fédèrent les acteurs autour d’un diagnostic partagé, et l’impact structurant de la restauration collective avec ses plus de 80 000 lieux en France.
INTERVENTIONS INSPIRANTES #1
L’état des lieux scientifique : comprendre pour agir
Yuna Chiffoleau : la résilience comme processus de transformation
La directrice de recherche à l’INRAE a posé les bases scientifiques de la réflexion en définissant la résilience des systèmes alimentaires comme leur capacité à résister aux crises, s’adapter et se transformer face aux perturbations multiples. Sa formule est restée dans les mémoires : « La résilience, ce n’est pas revenir à l’état initial, c’est avancer. » Cette approche dynamique distingue les crises externes subies (conflits, pandémie) des crises endogènes générées par le système agroindustriel lui-même, notamment sa contribution au changement climatique et à la dégradation des sols.
Yuna Chiffoleau a identifié deux leviers principaux pour construire cette résilience. La souveraineté alimentaire permet de reprendre le contrôle sur les dépendances et de développer l’autonomie territoriale sans viser une autosuffisance irréaliste et source de vulnérabilité. La transition agroécologique vise à diminuer les pressions environnementales qui menacent la sécurité alimentaire tout en valorisant les solutions basées sur la nature, comme la culture de légumineuses qui réduit simultanément l’usage d’engrais chimiques et le besoin d’importation de
protéines animales.
La transformation nécessaire s’appuie sur des actions collectives et des réseaux qui dépassent les seuls acteurs professionnels pour inclure collectivités, consommateurs, citoyens et associations.
Ces formes de coopération constituent des ressources pour adapter les systèmes alimentaires non seulement aux crises environnementales, mais aussi aux autres perturbations comme l’inflation ou la précarité alimentaire.
Sébastien Da Ros : mesurer pour piloter la résilience
Le développement de l’outil Provoly par OnePoint en partenariat avec le CNRA répond au besoin de disposer d’une vision intégrée de la résilience alimentaire territoriale. Cette plateforme centralise les données existantes de multiples sources (INRAE, Agence bio, INSEE,…) pour produire des indicateurs clés à l’échelle départementale, avec une évolution prévue vers les échelons EPCI et communaux.
L’innovation réside dans le croisement d’indicateurs agricoles et alimentaires traditionnels (population agricole, surfaces, nombre de PAT, points de distribution et transformation) avec des données climatiques actuelles et prospectives. L’intégration de prévisions de risque aux horizons 2030 et 2050 permet aux territoires d’anticiper les impacts du changement climatique sur différents aléas : sécheresse, inondations, incendies. Cette approche prospective vise à identifier les leviers prioritaires d’action pour chaque territoire selon sa vulnérabilité spécifique.
TABLE RONDE #1
La coopération territoriale : condition sine qua non de la résilience
L’expérience de la Dombes : pragmatisme et adaptation
Isabelle Dubois a livré un témoignage particulièrement éclairant sur les réalités de la coopération territoriale. La communauté de communes de la Dombes, territoire de 36 communes et 40 000 habitants situé à 30 km de Lyon, a d’abord tenté un Projet Alimentaire Inter-Territorial avec deux autres intercommunalités. Cette expérience s’est soldée par un échec instructif : les temporalités différentes, les attentes divergentes et les spécificités territoriales contrastées ont rendu impossible une approche commune.
Cette difficulté a conduit à repenser la coopération de manière plus souple, en maintenant les échanges sans le carcan d’une structure formelle commune.
Le territoire de la Dombes présente des spécificités remarquables : premier producteur français de poisson d’eau douce grâce à la pisciculture extensive, territoire historique d’élevage bovin, et zone humide d’intérêt international labellisée Ramsar. Ces atouts nécessitent cependant une coopération avec les territoires voisins, notamment la métropole lyonnaise qui compte plus de consommateurs que de producteurs.
Les actions concrètes développées illustrent une approche pragmatique de la résilience alimentaire. La veille foncière menée avec la SAFER accompagne la sensibilisation des exploitants de plus de 55 ans à la transmission, tandis qu’une plateforme de tests agricoles permet d’expérimenter de nouvelles cultures adaptées aux enjeux climatiques avec une dizaine d’agriculteurs volontaires. L’acquisition récente d’une propriété pour tester l’installation de personnes non issues du milieu agricole mobilise un partenariat exemplaire entre collectivité, chambre d’agriculture, SAFER, Terre de Liens et lycée agricole.
La Banque des territoires : financer la transition à grande échelle
Linda Reboux a présenté l’évolution récente de la Caisse des Dépôts, qui structure depuis cinq ans seulement une offre spécifique aux enjeux agricoles et alimentaires en réponse aux sollicitations croissantes des territoires. Cette intervention publique de long terme complète les acteurs traditionnels du financement agricole sur les projets de transition, articulant les trois piliers stratégiques du groupe : transition écologique, cohésion sociale et territoriale, et souveraineté.
L’accompagnement des territoires s’organise autour de trois métiers complémentaires. Le conseil prend la forme d’ingénierie pour structurer juridiquement et financièrement les Projets Alimentaires Territoriaux. Deux nouveaux dispositifs enrichissent cette offre : « Territoire Fertile », plateforme gratuite de sensibilisation et prédiagnostic développée avec Terre de Liens, la FNAB, le Basic et les Greniers d’Abondance, et « Territoire nourricier », parcours d’accélération pour les projets issus des PAT.
Les Démonstrateurs Territoriaux de Transition Agroalimentaire illustrent l’ambition de cette politique. Vingt-neuf territoires lauréats bénéficient de financements pouvant atteindre dix millions d’euros chacun, à condition de constituer un consortium associant au minimum une collectivité territoriale et d’autres acteurs. L’exemple de « Seine nourricière », porté par la Ville de Paris avec une vingtaine d’acteurs publics et privés, montre la capacité de ces dispositifs à créer de nouvelles formes de coopération, allant jusqu’à la création d’une association dédiée, « AgriParis Seine ».
Ces expériences révèlent néanmoins des défis récurrents. Les enjeux de gouvernance publiqueprivée génèrent parfois des méfiances, tandis que les questions de portage juridique et de répartition des risques complexifient les montages. Les aléas politiques, qu’il s’agisse d’élections municipales ou de renouvellements dans les chambres d’agriculture, peuvent remettre en cause la pérennité des projets, soulignant l’importance de l’inscription dans le temps long.
Vivalya : la logistique au service de la territorialisation
Olivier Feno-Feydel a apporté le regard du secteur privé sur la coopération territoriale à travers l’expérience de Vivalya, réseau de 14 associés distributeurs représentant 5 000 collaborateurs et
80 000 clients. Cette organisation privilégie délibérément la robustesse à la performance pure, distribuant 700 000 tonnes de produits par an via 73 dépôts et 1 200 camions circulant quotidiennement sur l’ensemble du territoire français.
La philosophie de Vivalya repose sur la conviction que « la coopération est plus forte que la concurrence », se traduisant par une « politique de l’escargot » matérialisée par l’outil « La Vie a du goût ».
Ce système permet à chaque restaurateur de connaître l’origine précise de ses approvisionnements selon une logique concentrique : plus les besoins augmentent, plus la zone de sourcing s’élargit, tout en privilégiant systématiquement le local et le français. Comme le résume Olivier Feno-Feydel : « On ne fait pas mûrir les tomates au chalumeau. »
L’intégration dans les Projets Alimentaires Territoriaux constitue un enjeu majeur pour Vivalya. Certaines régions ont initialement exclu les distributeurs de leurs PAT, créant parfois des doublons coûteux avec la reconstruction de hubs logistiques là où des solutions existaient déjà. Le réseau plaide pour un « compromis sans compromission » passant par un dialogue à livre ouvert entre producteurs, distributeurs et consommateurs, chacun devant couvrir ses charges spécifiques tout en recherchant la juste rémunération plutôt que l’optimisation de marges.
Les enseignements du sénateur Bleunven : pragmatisme et réalisme
Fort de son expérience d’élu local et de sa connaissance de l’agroalimentaire, Yves Bleunven a apporté un éclairage pragmatique sur les limites et potentialités de la coopération territoriale. Sa
mise en garde contre le « Yaka Faukon » résonne particulièrement : derrière l’apparente simplicité de mettre en relation directe producteurs et restauration collective se cachent des réalités logistiques complexes. L’exemple des carottes râpées du lundi matin illustre parfaitement cette complexité : pour que le produit arrive lavé et nettoyé à 8h en cantine, tout un processus amont
doit être organisé.
Le nerf de la guerre reste la logistique, et les modèles économiques des légumeries créées dans l’enthousiasme des débuts de PAT se révèlent souvent fragiles. L’élu cite l’exemple de l’abattoir de Belle-Île, qui coûte plusieurs millions d’euros pour traiter 70 tonnes de gros bovins par an : ramené au kilo, le coût d’amortissement serait prohibitif dans une logique purement privée. Cette réalité questionne la soutenabilité économique de certains projets locaux.
La contrainte budgétaire pèse de plus en plus lourdement sur les collectivités. L’évolution des coûts de restauration scolaire illustre cette tension : d’une contribution de 100 000 euros il y a dix ans, certaines communes sont passées à 200 ou 300 000 euros après le Covid et la mise en oeuvre d’EGAlim. La compétence PAT demeurant facultative pour les intercommunalités, des arbitrages difficiles s’annoncent dans un contexte budgétaire tendu.
La formule de Yves Bleunven « ne pas court-circuiter les circuits courts » synthétise sa vision pragmatique : plutôt que de créer ex nihilo de nouveaux outils, mieux vaut s’appuyer sur les opérateurs existants en les incitant à s’engager dans des pratiques plus vertueuses. Cette approche nécessite de mettre tous les acteurs autour de la table, y compris ceux parfois écartés
par principe des PAT.
INTERVENTIONS INSPIRANTES #2
Les dimensions sectorielles de la résilience
Le système alimentaire militaire : robustesse et anticipation
Steven Martin a apporté un éclairage original en présentant l’approche militaire de la résilience alimentaire. Le commissariat des armées, cinquième organisme de restauration collective français avec plus de 200 sites, illustre concrètement les enjeux d’anticipation et de sécurisation des approvisionnements. Les résultats obtenus dans la mise en oeuvre d’EGAlim (45% de produits durables dont 25% de bio) démontrent la faisabilité de ces objectifs, moyennant un effort financier significatif de 80 millions d’euros sur la période 2022-2025.
L’innovation technologique accompagne cette démarche, notamment avec la caméra « Scanaspi » dotée d’intelligence artificielle qui analyse les retours plateau en discriminant déchets évitables et inévitables. Cette approche a permis de réduire le gaspillage alimentaire de 34% en un an, passant de 85 à 56 grammes par assiette et par convive. Au-delà de l’aspect technique, cette expérience illustre l’importance de la boucle vertueuse associant analyse, modification des menus et adaptation des quantités servies.
Les spécificités militaires éclairent les enjeux civils de résilience alimentaire. La gestion de stocks d’autonomie variables selon le contexte géopolitique, les dispositifs de « food defense » pour protéger les approvisionnements, ou encore l’adaptation aux contraintes d’hypermobilité observées dans le conflit ukrainien nourrissent la réflexion sur l’anticipation des crises. Les innovations militaires, de la lyophilisation aux cuisines roulantes, enrichissent régulièrement les pratiques civiles.
L’outillage méthodologique : guide AFNOR et formation
Sandrine Espeillac a présenté l’aboutissement de deux années et demie de travail collaboratif avec le CNRA : un guide de bonnes pratiques mobilisant 200 participants de tous horizons et recensant 155 bonnes pratiques validées scientifiquement. Cette démarche illustre parfaitement la philosophie du CNRA : partir de l’existant plutôt que de réinventer, capitaliser sur les expériences territoriales, et produire un outil concret, opérationnel et pédagogique.
L’ampleur de la mobilisation témoigne de l’appétence des acteurs pour cette thématique : chercheurs, collectivités territoriales, entreprises, interprofessions, représentants des pouvoirs publics, startups et associations ont contribué à cette oeuvre collective. Les territoires pilotes de Saint-Malo et Toulouse ont permis de tester la pertinence des propositions avant la publication finale au Salon de l’Agriculture.
La formation développée par le CNRA complète ce dispositif en proposant des sessions adaptées au contexte spécifique de chaque territoire avec une approche multi-acteurs utilisant des outils d’intelligence collective. Le déploiement en Corse avec la DRAAF préfigure un essaimage national de cette offre de montée en compétences.
Comme le résume Sandrine Espeillac en citant le proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » Cette conviction irrigue également les discussions européennes en cours pour développer une approche stratégique commune face aux enjeux géopolitiques globaux.
TABLE RONDE #2
L’eau, ressource critique de la résilience alimentaire
Repenser la gouvernance de l’eau comme bien commun
Somhack Limphakdy a posé les bases conceptuelles d’une réflexion renouvelée sur l’eau en distinguant le « bien commun » (singulier) – modes pour vivre ensemble de manière pacifiée – des « biens communs » (pluriel) – ressources en indivision nécessitant une gouvernance collective. Cette approche dépasse la vision gestionnaire traditionnelle pour privilégier une approche « par le vivant » qui considère les bassins versants comme des organismes vivants à revitaliser.
Cette perspective holistique intègre l’agriculture dans une logique de bioéconomie répondant simultanément aux enjeux d’énergie, bâti, textile, transport, soin et éducation. La philosophe rappelle avec Churchill que « ce qui sépare la civilisation de la barbarie, ce sont cinq repas », soulignant l’urgence d’organiser une démocratie authentique autour de ces ressources vitales.
L’enjeu central réside dans la capacité à discriminer les crises endogènes générées par le système de celles subies de l’extérieur. Cette lucidité collective conditionne la possibilité de transformer des pratiques plutôt que de subir les conséquences de leur inadaptation aux nouveaux défis climatiques et sociaux.
Le modèle français de gouvernance de l’eau
Aude Witten a présenté le système français de gouvernance de l’eau comme un modèle envié internationalement, organisé selon un principe de « poupées russes » articulant directive européenne, bassins nationaux et commissions locales de l’eau. Ce système, fort de soixante ans d’expérience, met autour de la table des « parlements de l’eau » rassemblant élus, État, usagers
économiques et associations dans un équilibre défini par le code de l’environnement.
Le principe « l’eau paye l’eau » structure ce modèle par la collecte de redevances sur les prélèvements et dégradations de qualité, redistribuées selon une logique de solidarité financière et territoriale. Cette mutualisation permet d’organiser une « paix de l’eau » par opposition aux risques de « guerre de l’eau » qui menacent dans un contexte de changement climatique.
L’objectif de 70% des eaux en bon état en 2027 pour le bassin Adour-Garonne, avec une amélioration de 7 points lors du dernier cycle, démontre l’efficacité de cette approche. Cependant, les situations contrastées entre sous-bassins nécessitent des approches différenciées, comme l’ont montré les disparités lors de la sécheresse 2022 où certaines zones restaient en restriction en janvier 2023 tandis que d’autres avaient pu lever les mesures.
L’expérience industrielle bretonne
Marie Kieffer a apporté le témoignage concret de l’industrie agroalimentaire bretonne face aux enjeux hydriques. Avec 1 800 établissements dont 1 300 TPE de moins de dix salariés employant 72 000 personnes, ce secteur représente 12% de la consommation d’eau régionale répartie entre nettoyage (40%), utilités (chaud/froid), processus industriels et incorporation comme ingrédient.
La sécheresse 2022 a révélé la méconnaissance mutuelle entre industriels et parties prenantes, nécessitant une « acculturation accélérée » pour faire comprendre les spécificités de la transformation du vivant en flux poussé. Le développement du « kit sécheresse » en collaboration avec la CCI 56 a accompagné les entreprises dans l’optimisation de leurs consommations par l’installation de capteurs et compteurs sur les lignes de production.
L’évolution réglementaire récente autorisant la réutilisation des eaux usées traitées (début 2024) marque un rattrapage significatif avec dix ans de retard sur des pays comme la Belgique. Cette
ouverture illustre la nécessité d’adapter le cadre réglementaire aux enjeux contemporains, comme le plaide également l’industrie pour lever les verrous limitant les synergies entre acteurs.
La philosophie développée par Marie Kieffer résonne avec l’ensemble des témoignages de la journée : « On n’attend pas une subvention pour entamer sa transition. Les subventions doivent être des coups de pouce, pas des béquilles permanentes. » Cette approche vise à créer de la valeur ajoutée sur les territoires pour maintenir les entreprises localement tout en finançant les 6 milliards d’euros nécessaires à la décarbonation de l’agroalimentaire français.
Gouvernance territoriale et innovation organisationnelle
Les échanges ont révélé la richesse des innovations organisationnelles développées pour articuler les différentes échelles de gouvernance. L’exemple des préfets de sous-bassin coordonnant les arrêtés sécheresse pour éviter les incohérences entre rives illustre cette capacité d’adaptation. De même, les conditionnalités définies par le comité de bassin Adour-Garonne pour le financement du stockage de l’eau (stockage hivernal, projets multi-usages, transition agroécologique) montrent l’évolution vers des approches plus intégrées.
Les débats sur les « crédits eau » ou les paiements pour services environnementaux révèlent l’émergence de nouveaux modèles économiques valorisant les externalités positives. L’expérience Hauts-de-France avec McCain sur les PSE publics-privés préfigure des contractualisations innovantes entre coopératives, industriels et puissance publique.
Presse
Pour toute question relative à l’organisation de cette matinée, veuillez prendre contact avec notre responsable presse dont les contacts sont précisés ci-dessous.
Contact presse
Hermine CHOMBART DE LAUWE
contact@cnra-france.org
06 42 93 24 63
Partenaires

TerraGrow propose des solutions de gestions innovantes pour les agriculteurs. Faisant le pont entre l’agronomique, l’économique et la comptabilité, les solutions développées permettent aux agriculteurs de prévoir les aléas, financer la transition et gagner du temps dans le pilotage de leurs structures.

Onepoint accompagne les entreprises de la filière alimentaire dans leurs plans de transformation stratégiques, tactiques et opérationnels dans les secteurs de la production agricole, l’industrie agroalimentaire et la distribution alimentaire.

Le Réseau Vivalya est une coopérative de grossistes de proximité. Nous sommes spécialistes dans la sélection, la conservation et la distribution locale de fruits, légumes et produits de la mer frais, au service des professionnels la restauration collective et de la restauration commerciale.

Territoires de Démocratie Alimentaire vise à promouvoir, défendre et outiller pour l’application opérationnelle du concept de démocratie alimentaire. TDA accompagne l’émergence des territoires de démocratie alimentaire.

Entreprendre au profit de tous
Combattre les exclusions. Agir sur le terrain pour l’accès de tous à l’essentiel. Innover face aux défis de demain.
Un groupe associatif né en 1984 pendant les années sida, acteur majeur du vivre-ensemble, en France et dans le monde. Un impact auprès de 2 millions de bénéficiaires directs chaque année.